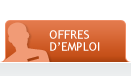-
Affaire c-53/04, marrosu et sardino, 7 septembre 2006, arrêt
– 20 oct 2006
Une réglementation nationale qui exclut la transformation en contrats à durée indéterminée de contrats à durée déterminés successifs conclu avec des employeurs relevant du secteur public n'est pas contraire à l'accord-cadre figurant en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée sous réserve que la réglementation en cause « c omporte une autre mesure effective destinée à éviter et , le cas échéant, à sanctionner une utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs par un employeur du secteur public ». L'absence d'une telle mesure conduirait à considérer la réglementation comme non conforme à l'accord-cadre. Voir également dans le même sens, l'affaire C-212/04, Adeneler, 4 juillet 2006. Le secteur public relève bien de l'exception sous réserve de l'existence de ces mesures effectives destinées à les éviter ou à les sanctionner. Effectives, c'est à dire concrètes et dont l'effet peut être mesuré par le juge.
-
Affaire c-484-04, commission c/ royaume-uni, 7 septembre 2006, arrêt
– 20 oct 2006
Manque à ses obligations dans la transposition de la directive, modifiée, 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, l'Etat membre qui prévoit que les travailleurs, dont une partie du temps de travail n'est pas mesuré ou prédéterminé ou peut être déterminé par le travailleur lui même, doivent bénéficier du droit au repos prévu par la directive mais qui dans ses lignes directrices adressées aux employeurs et aux travailleurs indique que l'employeur n'est pas tenu de veiller à la jouissance effective de ce droit aux repos. Il s’agit de la mise en oeuvre confirmée de la protection de la santé et de la sécurité du travailleur. Admettre de telles lignes directrices serait en réalité vider la directive de sa substance et soumettre le travailleur à des pressions indirectes auxquelles il ne saurait se dérober dans tous les cas.
-
Affaire c-81/05, cordeiro alonso, 7 septembre 2006, arrêt
– 20 oct 2006
Un salarié espagnol, M. Cordeiro Alonso est licencié pour un motif économique. Il introduit un recours contre cette décision qui aboutit à un accord avec son employeur sur le montant de l'indemnité à laquelle il peut prétendre. L'employeur n'acquitte pas sa dette et est déclaré insolvable. M. Alonso sollicite alors le fonds de garantie qui ne lui accorde que 40 % de l'indemnité négociée avec son ancien employeur au motif que la reconnaissance du montant de l'indemnité n'émanait pas d'un jugement ou d'une décision administrative. M. Alonso s'est pourvu devant les juridictions nationales compétentes. La juridiction de renvoi a sais la Cour de Justice. Pour la Cour, dans le champ d'application de la directive (modifiée) 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur , le principe général d'égalité exige que « lorsque, selon une réglementation nationale telle que celle en cause dans l’affaire au principal, des indemnités légales dues pour cessation du contrat de travail, reconnues par un jugement, sont à la charge de l’institution de garantie en cas d’insolvabilité de l’employeur, des indemnités de la même nature, reconnues dans un accord entre travailleur et employeur conclu en présence du juge et entériné par l’organe juridictionnel, doivent être traitées de la même façon ». Ainsi le juge national doit-il laisser inappliquée « une réglementation interne qui, en violation du principe d’égalité tel que reconnu dans l’ordre juridique communautaire, exclut la prise en charge, par l’institution de garantie compétente, des indemnités pour cessation du contrat reconnues dans un accord entre travailleurs et employeurs conclu en présence du juge et entériné par l’organe juridictionnel ». Ainsi la nature de l'accord ne saurait constituer un obstacle à la mise en oeuvre du principe d'égalité, alors même qu'il ne s'agit pas d'une décision administrative ou d'un jugement, l'objectif étant d'assurer une protection efficace du travailleur licencié.
-
Affaire c-526/04, laboratoires boiron, 7 septembre 2006, arrêt
– 20 oct 2006
Le laboratoire Boiron produit des spécialités homéopathiques qu'il vend directement ou par l'intermédiaire de grossistes répartiteurs. Au titre de la réglementation française il est assujetti à une taxe sur les ventes directes. Le laboratoire n'a déclaré que le chiffre d'affaires réalisé par vente directe, en excluant le chiffre d'affaires correspondant aux ventes réalisées par l'intermédiaire des grossistes répartiteur qui ne sont pas soumis à cette taxe. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale l'a réintégré dans le total des ventes. Elle a procédé ensuite à un redressement. Le laboratoire Boiron a contesté ce redressement devant les juridictions nationales au motif que l'absence d'assujettissement des grossistes répartiteurs constitue une aide d'Etat. Saisie, la Cour de Justice précise qu'un laboratoire pharmaceutique « est en droit d'exciper de ce que l’absence d’assujettissement des grossistes répartiteurs à cette contribution constitue une aide d’État pour obtenir la restitution de la partie des sommes versées qui correspond à l’avantage économique injustement obtenu par les grossistes répartiteurs ». La Cour ajoute que la réglementation nationale qui impose la charge de la preuve à l'auteur de la demande de remboursement n'est pas contraire au droit communautaire sous réserve que la charge de la preuve ne soit pas rendue impossible du fait que les données nécessaires à son administration ne sont pas susceptibles d'être obtenues par le demandeur. Dans ce cas le juge national doit avoir recours aux moyens procéduraux mis à sa disposition par le droit national y compris en ordonnant des mesures d'instruction nécessaires. Deux arrêts viennent de rappeler une position constante de la Cour européenne de Justice. La liberté d'établissement ne saurait voir son champ d'application restreint au motif que le prestataire de service n'aurait pas satisfait à un examen préalable de sa maîtrise de la langue du pays d'accueil. S’il s’agit en l’occurrence de deux arrêts concernant la profession d’avocat, il en va de même dans le cadre des professions de santé. Pour autant cela ne saurait signifier que l'absence de connaissance de la langue du pays d'accueil ouvrirait droit à la pratique de la profession. La sécurité du patient ne saurait être mise en jeu.
-
Affaire c-193/05, commission contre grand duché du luxembourg, 19 septembre 2006
– 20 oct 2006
« En subordonnant à un contrôle préalable de connaissances linguistiques l’inscription auprès de l’autorité nationale compétente des avocats qui ont acquis leur qualification dans un État membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg et qui veulent exercer sous leur titre professionnel d’origine dans ce dernier État membre, en interdisant à ces avocats l’exercice d’activités de domiciliation de sociétés et en les obligeant à produire chaque année une attestation d’inscription auprès de l’autorité compétente de leur État membre d’origine, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise. »
-
Affaire c-508/04, graham j. wilson, 19 septembre 2006
– 20 oct 2006
Arrêt concernant la liberté d’établissement, directive 98/5/CE, conditions d’inscription auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, contrôle préalable de la connaissance des langues de l’État membre d’accueil « L’article 3 de la directive 98/5 doit être interprété en ce sens que l’inscription d’un avocat auprès de l’autorité compétente d’un État membre autre que celui où il a acquis sa qualification en vue d’y exercer sous son titre professionnel d’origine ne peut pas être subordonnée à un contrôle préalable de la maîtrise des langues de l’État membre d’accueil . »
-
Actes de la conférence sur les services sociaux d'intérêt général du 30/05/06
– 13 juil 2006
Le collectif des acteurs des services sociaux et de santé français a organisé une conférence le 30 mai 2006 à Paris sur les services sociaux d'intérêt général. La FHF, membre de ce collectif, a participé à l'événement. Les actes de la conférence sont maintenant téléchargeables.
-
Actualité de la jurisprudence communautaire - affaire c-410/04, anav, 6 avril 2006, arrêt
– 29 mai 2006
La réglementation nationale qui autorise l'attribution, sans appel d'offres, par une collectivité publique d'un marché à une entreprise dont elle détient le capital n'est pas contraire aux articles 43 CE (droit d'établissement), 49 CE (liberté de prestation des services) et 86 CE (règles de concurrence) sous réserve que :
-
Actualité de la jurisprudence communautaire - affaire c-124/05, fnv, 6 avril 2006, arrêt
– 29 mai 2006
À quelles conditions le rachat des jours de congé est-il possible ? L'article 7 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects du temps de travail, remplacée par la directive 2003/88 CE du Parlement européen et du Conseil prévoit dans son point 1 au moins quatre semaines de congé annuel payé et dans son point 2 indique que « la période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacé par une indemnité financière, sauf en cas de relation de fin de travail ».
-
Actualité de la jurisprudence communautaire - affaire c-372/04, yvonne watts, 16 mai 2006, arrêt
– 29 mai 2006
Un patient qui ne peut se faire soigner dans un délai «médicalement acceptable» dans son pays peut se rendre dans un autre Etat membre pour y être traité, puis se faire rembourser. La juridiction nationale a la charge de définir ce délai, mais celui-ci ne peut excéder une période acceptable compte tenu d'une évaluation médicale objective des besoins cliniques de l'intéressé au vu de son état pathologique, de ses antécédents, de l'évolution probable de sa maladie, du degré de sa douleur et/ou de la nature de son handicap au moment où l'autorisation est sollicitée.